On nous présente depuis de nombreuses années l’équation nucléaire de base - la dissuasion - comme stabilisée entre un nombre réduit de ’’joueurs’’.
A savoir : les cinq puissances nucléaires reconnues (i. e : Chine, Etats-Unis, France, Royaume-Uni, Russie) et un nombre à peu près égal de puissances nucléaires dîtes ’’officieuses’’ (i. e : Afrique du sud, Corée du nord, Inde, Israël, Pakistan, etc) dont on sait pertinemment qu’elles possèdent l’arme nucléaire même si elles ne l’ont pas nécessairement reconnu officiellement [1].
A ce discours lénifiant et dans ce brillant ouvrage la journaliste indépendante Dominique Lorentz oppose une thèse inverse qui bouleverse nos préjugés, nous oblige à revoir des pans entiers de notre Histoire contemporaine, nous contraint à changer de perspective et de paradigme.
L’Arme atomique, partout et nulle part
Combien de pays détiennent-ils aujourd’hui la bombe atomique ? A cette question les citoyens du monde croient pouvoir apporter une réponse rapide et précise. Ils se trompent.
En effet, aux cinq puissances nucléaires ’’officielles’’ et aux cinq puissances nucléaires ’’officieuses’’ viennent aussi s’ajouter les pays dits ’’du seuil’’ : pays disposant de capacités techniques et technologiques nucléaires prétenduement ’’civiles’’ mais leur permettant néanmoins (puisque technologies ’’duales’’...) de développer un armement atomique et - donc - pays soupçonnés de pouvoir, éventuellement, franchir le pas pour se doter d’armes nucléaires [2].
Et c’est là que se situe la ’’zone grise’’ de la nucléarisation de la planète : soit aujourd’hui en fait une cinquantaine d’Etats [3].
Ainsi, si l’on prend l’exemple de l’Allemagne et du Japon - deux puissances auxquelles les traités et accords, politiques et militaires, de l’après seconde guerre mondiale interdisent théoriquement la possession de l’arme nucléaire - on découvrira rapidement que leurs territoires sont pourtant constellés de centrales nucléaires auxquelles sont accouplées des installations de retraitement des combustibles, d’enrichissement d’uranium et d’extraction de plutonium, bref : toutes les infrastructures nécessaires à la production de bombes atomiques [4] [5].
Bien entendu il existe aujourd’hui le Traité de non prolifération nucléaire (TNP-CTBT) du 1er juillet 1968, récemment dénoncé par la Corée du nord (bientôt par l’Iran ?). Lequel TNP-CTBT interdit normalement aux ’’puissances du seuil’’ de pouvoir se livrer à des essais leur permettant de vraiment tester leurs matériels et armements atomiques, faute de capacités informatiques que pas même la Chine (i. : l’un des cinq ’’grands’’ et pourtant ’’puissance nucléaire officielle’’) ne possède vraisemblablement à l’heure actuelle [6].
Mais c’est ainsi qu’il s’avère néanmoins que l’arme nucléaire peut aussi bien être partout et nulle part à la fois. Reste à savoir comment on en est donc arrivé là. En effet, en 1956 encore, si trois pays possédaient effectivement la bombe atomique (i. e : les Etats-Unis, l’Union soviétique et le Royaume-Uni, avec la participation technique du Canada), seuls les supers-Grands étaient effectivement en mesure d’opérer de tels transferts de technologies vers des Etats tiers...
Genèse et mécanismes de la prolifération mondiale
En fait tout aurait commencé au tout début des années 1950, quand Américains et Soviétiques sont parvenus à la conclusion que l’arme nucléaire ne pouvait verrouiller un espace indéfini. Notamment quand, en juin 1950, les Américains se sont rendus compte que leur arsenal nucléaire n’avait néanmoins pas empêché la Corée du nord d’attaquer la Corée du sud puis par la suite, à la mi-octobre 1950, la Chine communiste d’intervenir militairement en Corée [7].
Dès lors allait naître, dans la plus grande discrétion, une stratégie de prolifération visant à permettre à certains de leurs Etats alliés fondamentaux de disposer de moyens nucléaires de base afin de défendre seul et en toute autonomie leur territoire sans engager directement ni mettre directement en danger les systèmes centraux des alliances auxquelles ils appartiennent.
Bref : un système de dissuasion nucléaire globale organisé sous la forme de ’’sous-traitances’’ régionales.
Ainsi les Etats-Unis allaient aider le Royaume-uni, la France, l’Etat d’Israël, l’Afrique du sud, le Brésil (et bientôt l’Argentine, l’Iran du Shah et peut-être même l’Egypte de Sadate...) à entamer leurs programmes nucléaires civils et, par la force des choses, militaires. De même que l’URSS allait apporter son aide au programme nucléaire chinois naissant [8] Sans même parler des programmes nucléaires nés d’une ’’fertilisation croisée’’ issue des deux blocs (en Inde, au Pakistan, en Irak ainsi qu’en Chine : à partir des années 1970-1971-1972, au moment du rapprochament sino-américain) [9].
Mais c’est à partir des années 1970 que la machine de la prolifération visiblement s’emballe avec la fourniture de matériels et technologies nucléaires (notamment grâce aux Etats-Unis et à la France) et l’accession au rang de ’’pays du seuil’’ d’Etats comme le Pakistan, l’Irak, l’Iran (voire la Libye et l’Algérie...), bientôt menacés par la révolution islamiste. Pays bientôt autonomes et proliférants à leur tour, pays soumis à des tensions politiques internes qui en font les jouet de menaces fondamentalistes politico-religieuses.
Or, tout le problème actuel vient précisément que, pour ces pays vivant désormais leur ’’propre vie’’ et pour ces doctrines politico-religieuses aujourd’hui en expansion, la doctrine de la dissuasion nucléaire régionale qui avait présidé à l’armement atomique de leurs pays respectifs n’est sans doute plus un paramètre politique à prendre en compte.
Et l’Europe dans tout ça ?
Pertinent jusqu’au bout, l’ouvrage de Dominique Lorentz regorge de révélations et de mises au point. Ainsi, on y découvrira que c’est bien aux Etats-Unis (et en étroite coopération avec l’Etat d’Israël) que la France doit son armement nucléaire. Lequel, prévu dès le début des années 1950, doit alors moins au général De Gaulle (de retour aux affaires au tout début du mois de juin 1958...) qu’aux Présidents du Conseil de la IVe République Antoine Pinay [10], Pierre Mendès France [11] ou Félix Gaillard [12].
Mais, ce que l’on sait moins c’est que l’arme nucléaire française conçue avec des financements américains était en fait initialement destinée à être ’’partagée’’ entre la France et l’Allemagne. Tel était en tout cas l’objet de l’accord de défense et de coopération signé par Paris et Bonn en janvier 1957 [13], lequel accord portait en priorité sur les applications militaires de l’énergie nucléaire et ne prévoyait ni plus ni moins qu’une fabrication ’’franco-allemande’’ de la bombe atomique...
Or, comme on le devine, le général de Gaulle était fondamentalement hostile à la nucléarisation de la RFA, estimant que le redressement de l’Allemagne menaçait la position dominante en Europe de la France. C’est pourquoi, le 17 juin 1958 [14], à l’occasion de son tout premier ’’Conseil de défense’’, le général De Gaulle mit un terme à l’accord de coopération nucléaire franco-allemand signé à peine un an et demi plus tôt. Ce dont il devrait alors bientôt s’expliquer avec le Chancelier allemand Konrad Adenauer - mais tout à son avantage - lors de leurs entretiens bilatéraux des 14 et 15 septembre suivants qui se déroulèrent alors à Colombey-les-Deux-Eglises [15].
Garantissant à l’Allemagne fédérale l’alliance militaire et la protection amicale du ’’parapluie nucléaire’’ de la France mais offrant ainsi, à celle-ci, l’arme atomique ’’européenne’’ (initialement prévue pour l’OTAN...). Et cela, tout en continuant à bénéficier de la coopération financière et technologique initialisée par ses prédécesseurs avec les Etats-Unis et l’Etat d’Israël. A charge pour la France de prendre alors effectivement la défense de l’Allemagne fédérale sur le front ’’européen’’ de la guerre froide (et de la dissuasion nucléaire mondiale...).
Et c’est ainsi que le général De Gaulle ’’kidnappa’’ et ’’nationalisa’’ (au profit exclusif de la France...) l’arme atomique ’’franco-allemande’’ alors pourtant censée devoir devenir le ’’pilier’’ nucléaire d’une défense européenne autonome, dans le cadre de l’Alliance atlantique. Rarement un ’’rapt’’ aussi considérable ne fit si peu de bruit...
« Affaires atomiques » : un ouvrage donc recommandé, à lire absolument pour connaître les dessous d’une diplomatie contemporaine dont - par delà l’imposture des discours officiels - la réalité peut néanmoins apparaître clairement pour qui veut bien se pencher sur la question.
Un ouvrage d’autant plus troublant qu’il a été écrit à partir de sources ’’ouvertes’’ (i. e : articles de presse, documents officiels rendus publics et autres ouvrages sur la question, etc.) ne tombant pas sous le coup du ’’secret défense’’. Comme quoi, si la vérité est ailleurs, voire dérangeante, elle n’en n’est pas moins à portée de mains...
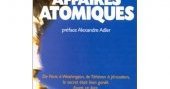
1. Le 2 janvier 2007 à 16:09, par Ronan En réponse à : Affaires atomiques
En réponse à : Affaires atomiques
- Informations complémentaires :
Juste noter que, pendant la guerre froide, la Suisse avait également souhaîté se doter d’un armement nucléaire : construisant des installations l’enrichissement de l’uranium puis (à la fin des années 1950) prenant des contacts avec l’Etat-Major de l’armée française (ainsi qu’avec les USA, le Royaume-Uni et l’OTAN...) pour acquérir une arme nucléaire ’’clef en mains’’ (avant d’abandonner finalement le projet, au milieu des années 1960).
De même que la Suède : qui avait également, durant les années 1950 et 1960, développé un programme secret d’arme nucléaire (dans l’objectif de se protéger d’une éventuelle invasion soviétique). Ce programme lui a même permis de réaliser une bombe atomique, mais il a finalement été abandonné en 1968 (après que la Suède eut ratifié le TNP).
2. Le 21 janvier 2008 à 18:07, par Ronan Blaise En réponse à : Affaires atomiques
En réponse à : Affaires atomiques
Nucléaire militaire, quand l’Espagne y allait Franco...
Où on apprend qu’au tout début des années 1970 l’Espagne du Caudillo (alors non signataire du TNP) voulait - elle aussi ! - se doter de la « Bombe » (et faire ses essais sur le territoire du Sahara occidental, alors territoire colonial espagnol...).
En tout cas, il s’agit là de fortes présomptions américaines (Sources : documents de la CIA - datés de mai 1974 - déclassifiés en ces derniers jours de janvier 2008) : inquiétudes relayées par « El Pais », le très sérieux quotidien de Madrid.
Suivre les commentaires : |
|
